Lors de la rédaction de mon dernier article Dompteur à la recherche de l’intériorité perdue, il y a eu un moment où j’ai malheureusement complètement perdu le sens de ce que j’avais à écrire. Beaucoup d’idées foisonnaient dans le sillage de cet ouvrage mais en revanche, le fil conducteur m’était devenu invisible et les mots ne formaient plus qu’un fatras incohérent. Il faut dire, en toute modestie, que le sujet était complexe et qu’il fallait beaucoup de doigté pour ne pas faire basculer le tout en un complaisant festival de considérations abstruses. Puis, dans une rubrique complètement étrangère au sujet de l’intériorité, intitulée Résolution nocturne #3, Hervé Bourgois m’a dit « le bon chemin est toujours le nôtre* ». Cette remarque a eu l’effet inespéré de sauver du naufrage l’épineux article que je n’arrivais pas à terminer. Je m’étais effectivement laissé coincer dans la pensée d’autres philosophes et par conséquent, j’essayais de mener à terme une réflexion qui n’était plus la mienne. Je devais par conséquent me la réapproprier en revenant à ce que cette réflexion appelait de viscéral en moi, à ce qui en ce problème me tourmentait et me gênait pour vivre.
« Le bon chemin est toujours le nôtre »: pourtant, il s’agit d’une remarque somme toute assez banale. Un nombre incalculable de films, de romans et même de philosophies font la promotion de cette idée, devenue centrale dans la pensée d’aujourd’hui. Aussi, cette idée, je puis certainement affirmer que je la connaissais déjà. Pourtant, en même temps, puisque son énoncé par la personne d’Hervé Bourgois m’a permis de terminer mon article, je dois aussi admettre que je ne la connaissais pas vraiment. Si bien que je me trouve maintenant dans cette posture extravagante où je puis affirmer que je connaissais et ne connaissais pas à la fois une même chose. C’est là un paradoxe si intriguant que je me dois absolument, en vertu de la mission philosophique dont le destin m’a investi, examiner ses tenants et aboutissants.
Tout d’abord, nous devons remarquer que la connaissance et la non-connaissance simultanée d’une chose n’est pas logiquement admissible. Il faut donc que la contradiction soit constituée par une confusion langagière, par exemple celle qui nous ferait confondre deux acceptations du mot connaissance. En l’occurrence, il pourrait certainement s’agir de la dichotomie constituée par les connaissances théorique et pratique. La connaissance théorique en est une d’ordre général, tandis qu’une connaissance pratique en est une d’ordre particulier. Par exemple, la proposition « tout ce qui monde redescend » est d’ordre général, dans la mesure où elle donne le schéma d’une relation de cause à effet, mais sans que ce schéma ne se rattache à quoi que ce soit de précis. En revanche, la propososition « lorsque je cogne la balle de tennis, elle finit toujours par redescendre » constitue une connaissance pratique, dans la mesure où elle se rapporte à une situation particulière que j’ai pu observer. Ainsi donc, pour le cas qui nous occupe, il est possible que je possédais déjà la connaissance théorique à l’effet que « le bon chemin est toujours le nôtre », sans toutefois posséder la connaissance pratique qui voudrait que « le bon chemin dans la rédaction de mon article Dompteur à la recherche de l’intériorité perdue est le mien ».
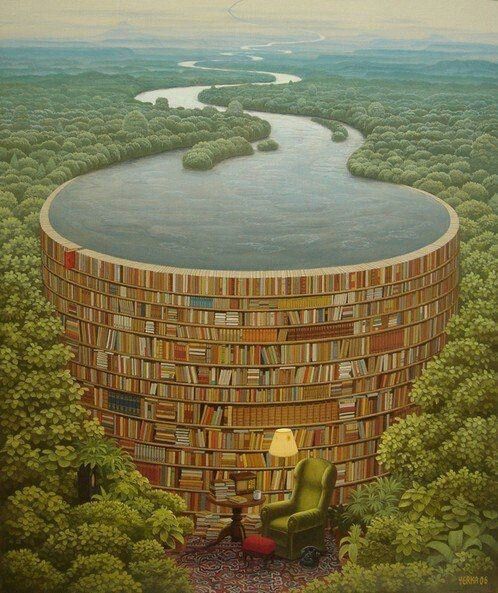
Pourtant, c’est une notion que je connaissais déjà sur un plan pratique, mais pour d’autres cas particuliers. Il m’est ainsi arrivé de me faire la même remarque lors de la rédaction d’autres articles. Seulement, la connaissance d’un cas particulier ne garantit nullement la connaissance d’autres cas particuliers semblables, loin de là. Le propre des cas particuliers est en effet de s’exclure les uns les autres. Ainsi, que j’aie déjà appliqué l’idée que « le bon chemin est toujours le nôtre » lors de la rédaction d’un précédent article n’a aucune incidence sur l’application de cette idée à la rédaction d’un nouvel article, si ce n’est que chaque cas particulier renforce la crédibilité de la connaissance théorique qui les englobe et augmente par le fait même les chances que cette connaissance soit appliquée à d’autres cas.
J’ajoute maintenant une remarque friponne à l’effet que même une connaissance d’ordre pratique a en fait toujours une teneur théorique. Lorsque je dis « quand je cogne la balle de tennis, elle finit toujours par redescendre », je tire cette règle en généralisant à partir de tous les cas particuliers où j’ai cogné la balle. C’est parce que la balle a toujours redescendu que j’ai pu inférer la règle générale que j’appelle maintenant une « connaissance pratique ». Appelons maintenant la connaissance de chaque cas particulier du comportement d’un même objet connaissance sensible. Cette dernière peut donc être dite la connaissance du comportement d’une chose à un moment « t », tandis que la connaissance pratique généralise sur le comportement répété de cette chose et finalement, la connaissance théorique généralise sur le comportement que plusieurs choses ont en commun.
Maintenant, serait-il possible de poursuivre la réduction en deçà de la connaissance sensible ? Pourrions-nous dire par exemple que la connaissance du comportement d’une chose – mettons la trajectoire parabolique (une ascension suivie d’une descente) d’une balle de tennis que l’on vient de frapper – n’est en fait que la généralisation de plusieurs états de cette chose ? Non car précisément, la trajectoire parabolique de la balle de tennis n’est pas la généralisation de chacun des états de cette balle au cours de son vol; c’en est plutôt l’assemblage. La trajectoire est constituée de tous les états du vol de la balle, alors que la règle « tout ce qui monde redescend » n’est pas constituée par tous les cas particuliers qu’elle recoupe. Nous avons donc à partir de ce point précis un changement complet de régime.

Qu’est-ce que cet « assemblage » des différents états d’une chose ? Comment notre entendement parvient-il à connaître et à nommer un tel assemblage ? Est-ce que nous collons, pour ainsi dire, tous les différents états de la chose jusqu’à former un bricolage complet sur lequel nous apposons une étiquette langagière ? En fait, l’action de nommer l’assemblage – par exemple la « trajectoire parabolique de la balle de tennis » – n’a de sens que dans la mesure où cet assemblage se présente à nous de manière répétée. Si la balle avait un comportement aléatoire, nous n’aurions aucune raison de nommer l’un quelconque de ses comportements possibles. La répétition, qui est le propre de la connaissance pratique, est donc ce qui fait entrer la chose dans le domaine de notre intellect. Car par le fait même, elle devient prévisible et donc susceptible d’être influencée et peut-être même contrôlée par notre action. Or, notre ingéniosité est telle que lorsque nous rencontrons une chose qui se répète et qui est donc d’intérêt pour nous, nous la marquons en quelque sorte au fer rouge pour être certains de ne pas l’égarer. Cette marque au fer rouge, c’est celle du symbole, du langage, de la dénomination. La réponse est donc définitivement non : il n’est pas possible de décomposer la connaissance en deçà de la connaissance sensible, car c’est en elle que se trouve le mouvement fondateur de toute connaissance – soit la la symbolisation. En fait, si nous voulions être des plus rigoureux, nous devrions supprimer l’appellation « connaissance sensible » pour la remplacer par celle de perception ou d’expérience, car le premier degré de la connaissance – soit la généralisation à partir d’un comportement répété, est le propre de la connaissance pratique.
Si la répétition est la condition de la symbolisation, elle l’est aussi de l’inférence qui nous permet de remonter de la connaissance sensible à la connaissance pratique. Ainsi, plus souvent j’observe la balle de tennis suivre une trajectoire parabolique, et plus les chances augmentent pour que j’en tire une règle telle que je puisse dire de manière raisonnablement fiable que cela se produira également à l’avenir. Le comportement généralisé de la balle me devient donc prévisible et j’acquiers par là une possibilité d’utiliser cette information à mon avantage. Le même processus se déroule en ce qui concerne le passage de la connaissance pratique à la connaissance théorique, sauf que la répétition concerne plusieurs objets. Si par exemple j’observe, en plus de la balle de tennis, qu’une balle de ping-pong a exactement le même comportement, c’est-à-dire que lancée dans les airs, elle suit inévitablement une trajectoire parabolique (ascendante puis descendante), alors cette répétition risque de faire entrer la règle dans le domaine de mon intellect. Elle devient prévisible et donne des possibilités à mon action. En outre, cela signifie que la règle acquiert une existence séparée des objets particuliers auxquels elle était liée dans la connaissance pratique, si bien que je puis maintenant lui donner un nom, tel que « force gravitationnelle ».
Dans le cas qui nous occupe, nous pouvons dire que je possédais déjà la connaissance théorique de la règle qui veut que « le bon chemin est toujours le nôtre ». Sans doute y étais-je parvenu à force d’accumuler à cet effet des connaissances pratiques dérivées de ma propre expérience (de mes connaissances sensibles) mais aussi, comme je l’ai dit en ouverture, par exposition à tous les produits culturels qui véhiculent cette idée. Maintenant, bien des facteurs peuvent entraver la libre application d’une règle théorique aux cas pratiques : par exemple le fait d’essuyer des revers en la matière. Peut-être avais-je commencé mon article d’une manière toute personnelle mais qu’ayant bloqué sur certains problèmes, j’avais arrêté d’y croire. Si tel est le cas comme je le pense, ma connaissance de la règle avait alors perdu en crédibilité et aussi, le lien qui va du général au particulier s’était au moins momentanément brisé. Je ne voyais plus le motif qui liait le chemin qui s’étendait devant moi avec clarté et par conséquent, il ne m’était plus prévisible que mon propre chemin finirait par être le bon. Mon action ne pouvait donc se déployer suivant ce plan et c’est pourquoi j’errais. Heureusement, le lien fut réactivé par une intervention imprévue.
* J’ai, à mon insu, trafiqué la formulation originale de l’intervention de M. Bourgois. Comme je ne m’en suis rendu compte qu’à la fin de la rédaction de cet article, et que cela ne change pas l’esprit de l’intervention en question, je ne prends pas la peine de corriger cet impair.
Ce que vous dites est étonnant ! Je retrouve un texte sans « prise », et cela vaudrait la peine de le comparer à l’autre. Ce n’est pas que je ne peux pas faire de remarques, mais que je n’ai pas d’angle pour le faire, ce qui induit que j’ai dû « m’égarer » moi aussi dans mes commentaires sur le texte précédent.
Cependant, lorsque vous parlez de la balle de tennis, vous faites comme si elle avait toujours existé, alors qu’elle a été créé parce qu’elle retombe, c’est pour cela que nous pouvons le déduire. J’aime à croire que n’importe qui pourrait l’avoir créée, mais ce n’est pas nous qui l’avons fait (dit).
Ce que j’avais dit, je ne sais plus où, mérite des précisions, car il faut comprendre « mon » et pas « nôtre ».
Une chose est belle parce que je la trouve belle, pas parce que la chose serait belle en soi. Je ne peux pas savoir pourquoi « d’autres » la trouvent laide. Pourtant, je la trouve belle parce que « d’autres » m’ont appris à la trouver belle. Mon chemin est « ce que je sais faire ». Pour faire autrement, trouver cette chose laide, je dois apprendre ce que d’autres savent faire. Je ne sais donc pas où vous avez trafiqué ma pensée, mais peu importe. J’ai compris suite à nos échanges que l’intériorité se cherche à l’extérieur de nous, pas à l’intérieur. Pour cela, il ne faut pas « s’égarer ».
J’aimeJ’aime
Je ne saisis pas ce que vous dites dans le premier paragraphe. Que voulez-vous dire par « texte sans prise » ? Et pourquoi dites-vous que vous vous êtes égaré dans les commentaires du précédent ?
Est-ce que je fais comme si la balle avait toujours existé ? C’est-à-dire que je n’en parle pas parce que je n’en ai pas besoin. Maintenant, sous-entendez-vous que cela suppose une faute logique ? Si c’est le cas, quelle est-elle ?
Votre texte original était « La bonne direction n’est-elle pas celle que l’on suit ? Et la mauvaise celle des autres ? » Bien entendu que vous parliez de vous-même, de votre expérience, mais vous aviez aussi le désir de faire valoir cette opinion, ne serait-ce que sous la forme aimable d’un questionnement (une forme adaptée au monde du libéralisme, de la guerre apaisée, où l’impératif catégorique devient un impératif hypothétique). D’où la reformulation inconsciente que j’en ai fait. La figure inclusive « le nôtre » peut être saisie comme une espèce de procédé rhétorique.
J’aimeJ’aime
Pour le texte « sans prise »… Je ne sais pas le définir clairement. Disons que c’est un texte que je ne sais pas mettre en défaut. Dans le cas contraire, cela signifierait que je pourrais me retrouver à débattre d’opinions, et donc « m’égarer ». Cela vaudrait la peine que je relise donc le texte précédent pour voir si c’est le cas. Il s’agissait d’une possibilité, pas d’une certitude. Mon étonnement provenait de cela, j’ai commenté votre texte précédent, alors qu’ici je ne savais pas le faire aussi facilement.
Je ne crois pas qu’il y ait une erreur de logique. C’est plutôt ce qui me semble être un manque ou quelque chose d’éclairant. Je voulais juste vous apportez un sujet de réflexion.
Il ne peut pas y avoir de connaissance pratique sans connaissance théorique (la théorie ne provient pas de l’expérience personnelle). C’est la théorie qui nous permet de savoir qu’une chose peut tomber. La théorie change alors l’environnement, l’homme évite de passer sous les cocotiers et invente la balle de tennis. Il n’a pas besoin de connaître la théorie, mais que quelqu’un lui enseigne la pratique. Lorsque nous déduisons la théorie, ce n’est donc pas la même chose que de l’inventer. C’est le « je » de « je tire cette règle de… » qui a attiré mon attention, car dans ce cas, nous ne faisons que « retrouver » une connaissance existante à partir des choses et de nos autres connaissances.
En disant cela, je ne parlais pas de ma propre expérience. Et ce n’est pas une opinion. D’où mon exemple sur la beauté. Il faudrait dire que pour « un individu lambda le bon chemin est le sien », c’est-à-dire celui qu’il connaît, mais comme vous le signalez votre formulation n’est pas ambiguë. Cet individu sera confronté à celui des autres qui ne peut pas être le bon pour lui, car il ne le connaît pas. Doit-il l’apprendre? Le problème de la guerre apaisée (ou pas), est contenu dans la réponse à cette question. Le bien et le mal ne peut se définir que « par ce qui est bien pour soi », alors que nous le considérons dans l’absolu (dans le sens de Platon où seuls les dieux peuvent nous le faire connaître) ou par ce qui est défini par d’autres (ce que cherchait Aristote, ce que nous faisons dans nos démocraties, ce que fait le pouvoir de l’argent). Dans les deux cas, il doit être « imposé » et c’est cela qui créé une « guerre éternelle » car les choses existent (comme la balle de tennis) et nous ne pouvons pas les supprimer. Le constat est ainsi formulé sommairement. Et la solution, s’il y en a une, ne peut pas passer par la « guerre »… Il est essentiel d’ajouter que, comme je le disais pour la beauté, « le bien pour soi » n’existe pas non plus dans l’absolu, c’est quelqu’un qui nous l’a enseigné (car il faut la théorie pour en déduire la pratique). J’y reviendrai :-).
Votre reformulation ne déforme donc pas ma pensée, mais est plus élégante :-).
J’aimeJ’aime
Je comprends que vous définissez la théorie comme le monde de nos anticipations du cours des phénomènes (la noix de coco pourrait tomber…), et la pratique comme la connaissance ‘in situ’ des gestes qui répondent à ces anticipations (ne pas passer sous le cocotier…) ?
Mais dans ce cas, l’expression « connaissance des gestes » induit en erreur il me semble. La notion de connaissance en appelle immanquablement à quelque chose qui relève de la théorie. J’ai essayé de faire ressortir cette ambiguïté dans l’article. Au final, je dis que les connaissances théorique et pratique relèvent d’un même mode. Seulement, nous distinguons, me semble-t-il, les deux pour des raisons qui tiennent à leur champ d’application. Nous disons qu’une connaissance est « pratique » lorsque nous voyons pertinemment en quoi le schéma qu’elle contient est utile. Tandis que la connaissance théorique recèle quelque chose de foncièrement inutile (theorein: contemplation, spéculation, etc.). Évidemment, la théorie n’est pas inutile puisque sinon, nous ne théoriserions pas. Mais son utilité est de l’ordre de la prospection. C’est en quelque sorte une utilité pariée. Les savants sont de grands parieurs. La plupart des gens ne le sont pas.
Je suppose que nous considérons le bien et le mal selon une perspective impersonnelle car tel est l’état d’esprit que semblent appeler la vie collective et la vie politique. Quant à la perspective « absolue », elle relève d’une lassitude de la guerre.
Au fait, avez-vous observé que le problème de la guerre peut être étendu au tout de la nature ? La situation n’est pas différente avec les animaux, les plantes ou l’océan: nous avons des vues divergentes quant à ce qui doit être. La différence est que nos communications avec ceux-ci sont plus sommaires. Nous pourrions peut-être même étendre la guerre à notre opposition occasionnelle (qui augmente avec le temps) avec notre propre corps. Dans ce domaine-là aussi nous avons notre bien absolu, notre bien selon les autres. Remarquez bien que la guerre avec notre propre corps n’est au fond que l’intériorisation de notre guerre avec l’opinion des autres. Où le « je » s’identifie avec une opinion extérieure et où le corps s’arroge le camp de ce qui nous est personnel. L’intériorisation en question réside alors, comme je le disais dans mon autre article, dans le monde de distorsions cognitives (les opinions d’autrui) qui m’empêche de vivre au présent.
J’aimeJ’aime
J’ai l’impression qu’il y a une différence entre ce que je dis et ce que vous dites, mais je n’arrive pas à la percevoir nettement. Ce n’est peut-être qu’une impression…
Nous utilisons ici le mot théorie pour parler de la relation de cause à effet, « le nuage anticipe la pluie ». Je dis que nous ne pouvons pas la déduire d’une expérience personnelle, « en observant les nuages ». Celui qui a créé cette connaissance (théorique) et ceux à qui il l’enseigne, peuvent déduire des comportements associés à des connaissances pratiques et les enseigner, « se mettre à l’abri lorsqu’il y a des nuages parce qu’il pourrait pleuvoir » (l’anticipation est liée au comportement, pas au « phénomène », peu importe qu’il pleuve ou pas). Nous n’avons alors pas besoin de la théorie pour apprendre « les gestes », et c’est à partir de la connaissance pratique que nous pourrions « retrouver la théorie ». Vous n’avez pas fait d’erreur de logique car effectivement la « balle de tennis existe déjà », mais ce que vous décrivez est la façon dont nous pourrions « retrouver » la connaissance théorique à partir de la connaissance pratique, parce qu’elle existe déjà. Ce n’est pas ainsi que nous créons la connaissance théorique.
Je crains que l’expression « connaissance des gestes » soit effectivement mal appropriée, car justement il n’y a pas de connaissance (ni pratique, ni théorique). J’ai beaucoup progressé dans ma réflexion mais je n’ai pas pu écrire des choses aussi fausses, alors j’ai recherché: « La connaissance est le mot de notre langue qui désigne ce dont nous pouvons parler. Nous nommons celle du chat connaissance par abus de langage, puisqu’il ne sait pas parler. Il est donc préférable de les (ce serait plutôt la) nommer connaissance des gestes, la connaissance n’étant que leur interprétation »… En fait, j’ai utilisé cette expression pour tenter de distinguer ce que nous faisons (dont nous ne savons rien), de ce que nous pouvons dire. Ce que nous faisons, nous les hommes, se déduit de la connaissance pratique déduite elle-même de la connaissance théorique. La connaissance pratique est ce qui nous permet d’apprendre à faire, « j’ai appris que lorsqu’il y avait des nuages, je devais me mettre à l’abri », alors que la connaissance des gestes, c’est seulement ce que notre corps a appris… Je dirais maintenant que « le corps n’a pas de mémoire »… Le chat n’a pas de connaissance (seulement celle des gestes…), comment dire alors que nous pouvons observer le résultat d’un apprentissage, alors qu »il n’a rien appris?
Comme il n’a pas de connaissance, il ne fait pas la guerre… c’est nous qui le disons. Nous ne pouvons pas observer de guerre dans la nature (indépendamment de l’homme), car il faut des « choses dites », des connaissances pratiques pour pouvoir la faire. En disant cela, nous ne faisons que donner des opinions sur la nature, nous faisons la guerre avec « elle », c’est « mal » que dans la nature les animaux puissent se nourrir les uns des autres, et comme dans la société, en lui faisant la guerre, nous créons des « guerres éternelles » avec elle. Le bien et le mal est un sujet complexe, je préfère le laisser là pour le moment. Ce n’est pas que je puisse ne pas être d’accord avec ce que vous dites, mais plutôt que je n’arrive pas à le savoir car c’est trop synthétique. Le « bien et mal » n’est pas une guerre individuelle de soi contre les autres, et la guerre n’est pas indépendante de ce qui existe (de la balle de tennis).
La difficulté est que nous ne pouvons pas parler de l’inconnaissable, alors que nous sommes contraints de le faire si nous voulons le distinguer du connaissable. Ainsi, j’ai encore le même problème (selon ma sœur) sur mon dernier post où j’utilise le mot « être » pour désigner des êtres animés ET inertes, et le mot chose pour parler non pas des êtres inertes mais de toutes les choses dont nous pouvons parler. L’être est ce qui est inconnaissable, nous n’avons pas de mot pour en parler. Faut-il en créer un?
J’aimeJ’aime
En jouant au tennis, je peux apprendre que lorsque l’adversaire frappe un coup comme s’il allait trancher la balle sur l’horizontale (un coupé), la balle a tendance à rebondir moins haut. C’est quelque chose que je peux apprendre à partir de mon expérience. Mon apprentissage dans ce cas-là est de l’ordre du conditionnement: j’associe la position de la raquette de mon adversaire avec l’effet prévisible de la balle. C’est mnémonique. Je n’ai pas à connaître les mots qui me permettent de parler de cette connaissance. Pour en parler, il faut que je saute dans le monde des conventions langagières de Wittgenstein.
Si je comprends bien, vous utilisez le mot « théorique » précisément lorsque nous nous situons dans ce monde de conventions, et le mot « pratique » lorsque nous sommes le monde des conditionnements. Est-ce bien cela ? (même si nous convenons tous deux que l’expression « monde des conditionnements » est un abus de langage, comme d’ailleurs celle de « connaissance sensible »).
Maintenant, l’instructeur de tennis accompagnera sa démonstration des gestes qui entourent la production et l’anticipation d’un coupé par des paroles. Ces paroles agissent comme une sorte d’accélérant. Comme un doigt qui pointe. Les paroles disent « regardez ça ici et ça là ». Les paroles découpent le présent et en isolent ce qui importe dans la situation donnée. De plus, l’instructeur m’apprend les nouveaux mots qui servent à identifier les nouveautés dans cet apprentissage, de façon à ce que nous puissions en parler plus tard – par exemple pour que la notion de coupé soit insérée dans une leçon de stratégie.
Je disais dans mon texte que la connaissance pratique a pour propriété d’être utile. Or, si elle est utile, c’est forcément que les gestes sont connus, que la parole s’est doublée d’un conditionnement acquis par l’entraînement. Elle est un pari remporté.
J’aimeJ’aime
Ce n’est pas ce que je voulais dire. Je cherche à insérer cela dans un mouvement plus global, celui de l’individu et celui de l’homme, alors que vous vous situez dans un mouvement, avant je ne savais pas, après je savais, ce qui nous confronte au même problème qu’avec le chat qui peut apprendre sans n’avoir rien appris (nous ne savons pas distinguer l’écart entre ce que vous saviez et ce que vous savez).
La théorie c’est la définition du mot quand elle existe, c’est une cause, tous les points sont à la même distance du centre, pour ce qui concerne la sphère. Aujourd’hui, nous pourrions dire que c’est la science. La connaissance pratique ce sont les choses que nous pouvons dire pour faire quelque chose de la sphère, je peux prendre un avion pour faire le tour de la terre car c’est une sphère, et je n’ai pas besoin de savoir ce qu’est une sphère pour cela. Quelqu’un peut me l’enseigner, mais je peux aussi arriver à prendre l’avion sans que personne ne me l’enseigne, et même en déduire la définition de la sphère, parce que j’ai d’autres connaissances qui me le permettent. C’est ce que vous décrivez dans votre exemple. Mais je ne peux le faire que parce que l’avion existe, et c’est le cas parce que la sphère existe que quelqu’un lui a donnée une définition. C’est lui qui a généralisé, créé la chose universelle. Et sans la connaissance de la sphère, nous ne pouvons pas déduire la connaissance pratique qui en découle. Par conséquent, celui qui a créé la sphère n’a pas pu le faire par expérience individuelle (ce serait moins ambigu de dire en observant ses propres agissements). Alors que bien entendu, nous apprenons par nos expériences, y compris la théorie… Il en résulte que la sphère n’a pas toujours existé, comme la balle de tennis.
Je ne parlais pas des gestes, car la connaissance pratique s’exprime par le langage. Le lien entre les gestes et la connaissance est un sujet tout aussi délicat. Je pense aussi que cela est indépendant des conventions langagières bien que le résultat de l’apprentissage soit bien « un jeu de langage ». Je n’aime pas beaucoup le mot conditionnement, car nous ne pouvons pas considérer que l’homme puisse exister en dehors d’une communauté, et je ne pense pas que ce que lui apprend sa communauté soit du conditionnement. Est-ce que parler en français est un conditionnement?
J’aimeJ’aime
« C’est là un paradoxe si intriguant »… Je me demande si le paradoxe (en général) n’est pas seulement deux opinions qui nous empêchent de sortir du cadre (ce que Watzlawick exprimait par « patate ou pomme de terre » pour faire suite à une histoire de la dernière guerre mondiale). Il en découle que le résoudre c’est l’éliminer, ce n’est pas prendre partie. Ceci m’a poussé à réviser mon post sur le paradoxe d’Achille et la tortue que j’avais publié trop rapidement.
J’aimeJ’aime
Vous n’avez pas tort. Le paradoxe se manifeste par une contradiction logique qui semble inacceptable, qui heurte le sens commun, mais à laquelle nous devons tenter de faire de la place. On m’a déjà dit que je suis un individu paradoxal parce que j’occupe un emploi technique et suis passionné de philosophie. Cela veut seulement dire que c’est une cohabitation d’attributs qui choque nos habitudes de pensée. La personne qui me l’a dit devait être bouleversée dans ses connaissances psychologiques.
J’aimeJ’aime
C’est pourquoi un paradoxe est toujours une bonne occasion de réfléchir.
J’aimeAimé par 1 personne
Est-ce que parler en français est un conditionnement ? Lorsque l’enfant apprend à associer un mot à un objet, il y a certainement un mécanisme de conditionnement. Il va d’abord associer, le sourire, le rire, l’émerveillement du parent au mot, puis l’obtention d’une chose. Les premiers mots appris sont des choses que l’enfant peut obtenir: lait, papa, maman, lit, pipi, caca, etc. De la même manière que le chien de Pavlov associe la clochette à la nourriture, l’enfant associe le geste induit au geste langagier. Le lait, qui est en tant que concept un véritable carrefour de gestes possibles à induire, est au début réduit à un seul geste, celui qui est le plus utile pour l’enfant: celui d’obtenir un biberon. Plus tard, le parent précise le geste langagier: il ne faut pas dire seulement « lait » mais bien « je veux du lait ». Parallèlement, d’autres phrases impliquant le lait peuvent être développées. Le carrefour se dessine.
Il serait alors tentant d’affirmer que toute l’acquisition du langage n’est qu’un immense mécanisme de conditionnement qui ne fait que gagner en complexité mais à un moment donné, l’enfant commencer à jouer, à expérimenter avec ses acquis. Il teste des combinaisons inédites. Il invente aussi. La faculté de l’enfant gagne une nouvelle propriété essentielle: la plasticité.
Ma fille, exaspérée par mes piètres talents de guitariste, m’a déjà demandé d’arrêter de « musiquer ». D’un côté, nous pouvons dire qu’elle a inventé un mot. De l’autre, elle n’a fait que combiner des éléments langagiers binaires: la musique associée au son que je produisais avec la guitare et la forme infinitive en « er », qui désigne une activité quelconque. Je ne lui ai pas enseigné l’existence de ces éléments. Elle les a inconsciemment isolés. Est-ce que le mécanisme par lequel elle a associé l’infinitif à l’activité est un conditionnement ?
Qu’est-ce qu’un conditionnement ? L’acquisition d’un comportement de manière inconsciente ? Mais quand je dis « je me suis conditionné à toujours faire mon lit en me levant », cela ne dénote-t-il pas une démarche consciente ? C’est-à-dire que je vais utiliser cette expression lorsque le comportement est « inscrit » en moi, que je n’ai plus besoin d’y « penser », de me le formuler.
J’aimeJ’aime
Donc, d’après ce que vous dites tout est conditionnement. La seule façon de sortir d’un conditionnement est d’en apprendre un autre ou de l’inventer à partir de ceux qui existent. La « guerre » existe parce que certains veulent imposer les leurs aux autres en le justifiant par le bien et le mal. Mon souci est alors, est-ce que l’homme est maître des conditionnements qu’il imagine ou est-ce qu’il les créé par hasard? Ce qui signifierait que l’homme ne peut pas plus changer la société dans laquelle il vit, qu’un chien ne peut changer le patrimoine génétique de son espèce. C’est le plus fort, celui qui est capable de se reproduire pour le chien, ou d’imposer ses conditionnements pour l’homme, qui est susceptible de gagner la guerre, seulement « si Dieu (le hasard) le veut ». Je n’ai pas la réponse à cette question, mais je voudrais croire que cela est possible. C’est pourquoi, je ne vois pas bien ce que peut-être la « guerre apaisée ».
Je crois (je ne suis pas encore certain de ma démonstration) que tout ce que nous apprenons nécessite la conscience, l’inconscient étant (outre ce dont nous ne pouvons pas avoir conscience) ce à quoi nous ne pouvons pas associer de mots. Pourtant, nous ne pouvons apprendre que des choses pour lesquelles les mots existent déjà, de la même façon que le chat pourchasse les souris parce qu’elles existent. Un petit enfant apprend le mot « caca » pas parce que la chose existe, mais parce que le mot existe, qu’il est associé à des comportements imaginés par l’homme depuis que l’homme a créé le mot (qui ont pu évoluer au travers d’autres mots). Nous lui enseignons ET le mot et les comportements. Il n’en a pas conscience lorsqu’il apprend les comportements sans les mots. Nous ne savons pas la part d’inné dans ces comportements, ceux qui existaient avant que le mot n’existe, mais nous pouvons les déduire, ce sont tous ceux qui n’anticipent pas, qui n’ont pas de finalité (qui est une chose humaine). Chasser une souris n’a pas de finalité pour le chat, c’est nous qui disons qu’il y en a une. Lorsqu’il y a une finalité, nous ne pouvons pas savoir si elle est en accord avec l’inné, si nous sommes mieux ou moins bien adaptés à la nature (l’utilité est une chose humaine). Nous ne savons pas comment nous apprenons, seulement que nous avons appris, car c’est le corps (inconnaissable) qui apprend ce que l’esprit (d’autres hommes) a imaginé. Le corps n’apprend que des gestes (à dire et à faire), il n’a donc pas de mémoire, l’esprit peut lui associer les mots dont se déduisent les comportements. La mémoire est celle de l’esprit. C’est le corps qui enrichit l’esprit, nous ne pouvons donc pas savoir comment.
Le cadre du conditionnement est le langage, nous ne pouvons pas en sortir. Nous ne comprenons pas les textes anciens car nous sortons du cadre, nous pensons qu’il y a quelque chose à comprendre (comme nous pensons qu’il y a quelque chose à comprendre quand un chat pourchasse une souris), et il en ira sans doute de même pour ceux qui nous lirons dans quelques milliers d’années, en supposant que la connaissance évolue et contraigne le langage à évoluer comme ce fut le cas. Lorsque nous ne sommes pas compris c’est lorsque nous voulons sortir du cadre, comme lorsque je dis que: « le chat apprend alors qu’il ne peut rien apprendre » ou que « le corps n’a pas de mémoire ».
Ce qui m’amène au fait que vous n’avez pas dit si vous aviez compris ce que je voulais dire… si vous avez détecté une erreur de logique?
J’aimeJ’aime
Si je veux me sortir du conditionnement qui me fait faire le lit à chaque matin en me levant – parce que je le fais de manière robotique sans souci des conditions (par exemple même si je suis en retard pour le travail) alors je devrai déployer des moyens mnémotechniques pour étendre le spectre des possibilités qui m’apparaissent au moment de me lever. Par exemple, une affiche sur le mur « ne pas faire le lit ». Cela revient à me conditionner à ne pas faire mon lit.
Une autre possibilité est de me conditionner à regarder l’heure avant de faire le lit et de le faire seulement si je ne suis pas en retard. Il y a donc un conditionnement qui s’ajoute pour assouplir le conditionnement précédent. Pourra-t-on dire que je suis conditionné à faire mon lit en me levant lorsque j’en ai le temps ? L’usage commun interdira une telle formulation. Le conditionnement se rapporte à un comportement rigidement déterminé. Or, si un comportement est conditionnel, nous dirons qu’il n’est pas rigidement déterminé.
Mais cette notion de « rigidité » comporte quelque chose de subjectif. On peut parler de conditionnement de masse parfois, par exemple pour décrire la prégnance des comportements du consumérisme d’aujourd’hui. Mais pourtant, cela réfère à des comportements qui n’ont pas la bête rigidité de celui qui fait son lit de manière robotique. Il faudrait dire que celui qui utilise le mot « conditionnement » a un point de vue extérieur et détient des informations que l’être conditionné n’a pas. Si je m’auto-diagnostique un conditionnement, alors celui qui parle en moi n’est, d’un certain point de vue, pas le même que celui qui exécute le comportement conditionné.
Est-ce que la contemplation est le remède du conditionnement ? Lorsque je contemple, je n’agis plus, je ne fais que travailler à étendre le spectre de mes possibilités. 2 types de contemplation: la réflexion et la contemplation des produits culturels. Le danger est de faire de la contemplation une fin en soi. Où pourrait-elle être envisagée comme fonction sociale en vue de laquelle des individus doivent en faire une fin en soi ?
***
Vous dites que le corps n’a pas de mémoire parce que la mémoire est une chose alors que le corps est un être. Est-ce exact ? Mais alors, pourquoi ne pourrions-nous pas le dire quand même par métonymie, un peu comme vous dites « connaissance sensible » pour désigner les comportements qui s’inscrivent dans le corps ?
***
Je ne comprends pas votre question. Si j’ai détecté une erreur de logique où exactement ?
J’aimeJ’aime
Dans sa lettre aux instituteurs Jules Ferry disait : « De même, l’enfant qui répète les premiers préceptes de la morale ne sait pas encore se conduire : il faut qu’on l’exerce à les appliquer couramment, ordinairement, presque d’instinct ; alors seulement la morale aura passé de son esprit dans son cœur, et elle passera de là dans sa vie ; il ne pourra plus la DÉSAPPRENDRE. » Mais il pourra appendre d’autres choses en plus.
Je n’ai pas de réponse à vos remarques qui sont pertinentes. Les sociologues utilisent le terme d’habitus que je préfère à celui de conditionnement. L’habitus nous éloigne du conditionnement de Pavlov. Un habitus est ce que nous faisons quand « rien ne change », ce qui intègre donc la notion de « conditionnel » que vous évoquez. Dans l’exemple du lit, c’est un habitus, mais vous pourriez oublier de le faire pour une raison ou une autre et rentrer chez vous et voir avec surprise que vous n’aviez pas fait votre lit. Vous partagez cet habitus avec d’autres personnes. Nous ne savons pas exactement comment vous l’avez acquis, ce n’est pas quelqu’un ou quelque chose qui vous a conditionné avec une intention, comme dans le cas du chien.
Nous ne serions rien si nous n’avions pas des habitus (des conditionnements), c’est cela qui nous permet de vivre en communauté et de nous comprendre les uns les autres, d’atteindre un bonheur humain dans la mesure où ce qui le remet en cause n’est pas trop pesant. C’est ce que vous enseignez à votre fille, des habitus, et elle les apprend naturellement, car son « bonheur » est d’être adaptée à son environnement. La seule chose qui empêche d’atteindre ce « bonheur » ce sont ceux qui veulent nous en faire changer, alors que nous ne savons pas ou plus le faire (comme vous le remarquez et comme le dit Jules Ferry), en nous imposant les LEURS. Mais ce n’est pas aussi simple que cela, il manque d’autres paramètres.
La mémoire est une chose et je suis un être (caractérisé par le corps), disons un corps. La mémoire peut caractériser mon corps, c’est ce que nous faisons en disant que mon corps a une mémoire. Cela signifie qu’un observateur peut constater que mon corps ne savait pas une chose et qu’ensuite il la savait. Il en déduit que mon corps l’a mémorisée. Jusqu’à présent, c’est vous qui avez raison. Le problème c’est que mon corps ne le sait pas, c’est l’observateur qui le sait. Si vous me posiez la question de savoir ce que je pourrais dire ou faire, mon corps ne saura pas vous répondre. Il répondra une vague liste qui ne sera que la réponse attendue à une telle question, et qui ne sera pas la même à un autre moment, car il apprend en permanence et que les perceptions ne sont jamais les mêmes… Donc, mon corps n’a pas de mémoire, c’est un observateur qui le dit (ou peut le dire). Il en résulte que dire que ma mémoire caractérise mon corps et que mon corps a une mémoire, n’est pas tout à fait la même chose… C’est l’esprit (ce que nous pouvons dire) qui permet de dire que mon corps est caractérisé par une une mémoire, ce n’est pas mon corps (ce que je fais ou dis) qui en a une. Comment le dire autrement?
Il y a un autre angle qui est de dire que la mémoire est celle de la chose dite, mais je m’y suis perdu… Il me semble que dans mon essai il y a un passage qui tente d’expliquer cela différemment. L’idée est que le corps est une chose (qui caractérise les êtres) et que par conséquent c’est un mouvement (je ne le démontre pas ici), dit autrement il évolue en permanence et ne conserve que le résultat présent. Ce n’est pas la mémoire du passé. Tout cela n’est pas anodin, car c’est ce qui conduit à démontrer que nous ne pouvons pas désapprendre. Et c’est pour cela qu’Aristote, comme Jules Ferry, et comme tous les dictateurs, cherchent à enseigner les habitus à l’école. Mais, cela ne fonctionne pas, car les choses (la balle de tennis, l’avion..) existent…
A cela s’ajoute le fait que dire que le corps (une chose pas un être) a une mémoire est inintelligible, SAUF en médecine (car la mémoire est alors une partie du cerveau). Lorsque nous parlons de cette zone cérébrale que nous nommons la mémoire, nous pouvons dire que le corps a une mémoire, mais nous parlons d’un être, ce n’est plus une chose. En le caractérisant, nous ne trouverons que la façon dont le corps peut dire ou faire des choses. Cela sert à détecter des dysfonctionnements cérébraux. Je ne suis pas certain (il faudrait y réfléchir) qu’il soit impossible de trouver dans cette zone cérébrale, tout ce que nous pourrions dire, mais nous en sommes très très loin. Il en résulte que lorsque des philosophes ou des scientifiques cherchent les fondements de la conscience dans un être cérébral, ils ne les trouveront pas. Car la conscience n’est pas un être, mais une chose. Platon pensait que les Idées étaient des êtres divins, les philosophes modernes pensent que ce sont des êtres matériels. Est-ce que ce sont les mêmes habitus?
« Je ne comprends pas votre question. Si j’ai détecté une erreur de logique où exactement ? » Je ne sais pas où :-). Je suis certain de ce que j’avance, mais je peux aussi me tromper sans le savoir. Alors, je pose la question car vous auriez pu détecter des erreurs, « des choses qui ne peuvent bien évidemment pas être ainsi à cause de ceci ou de cela », sans m’en alerter.
J’aimeJ’aime